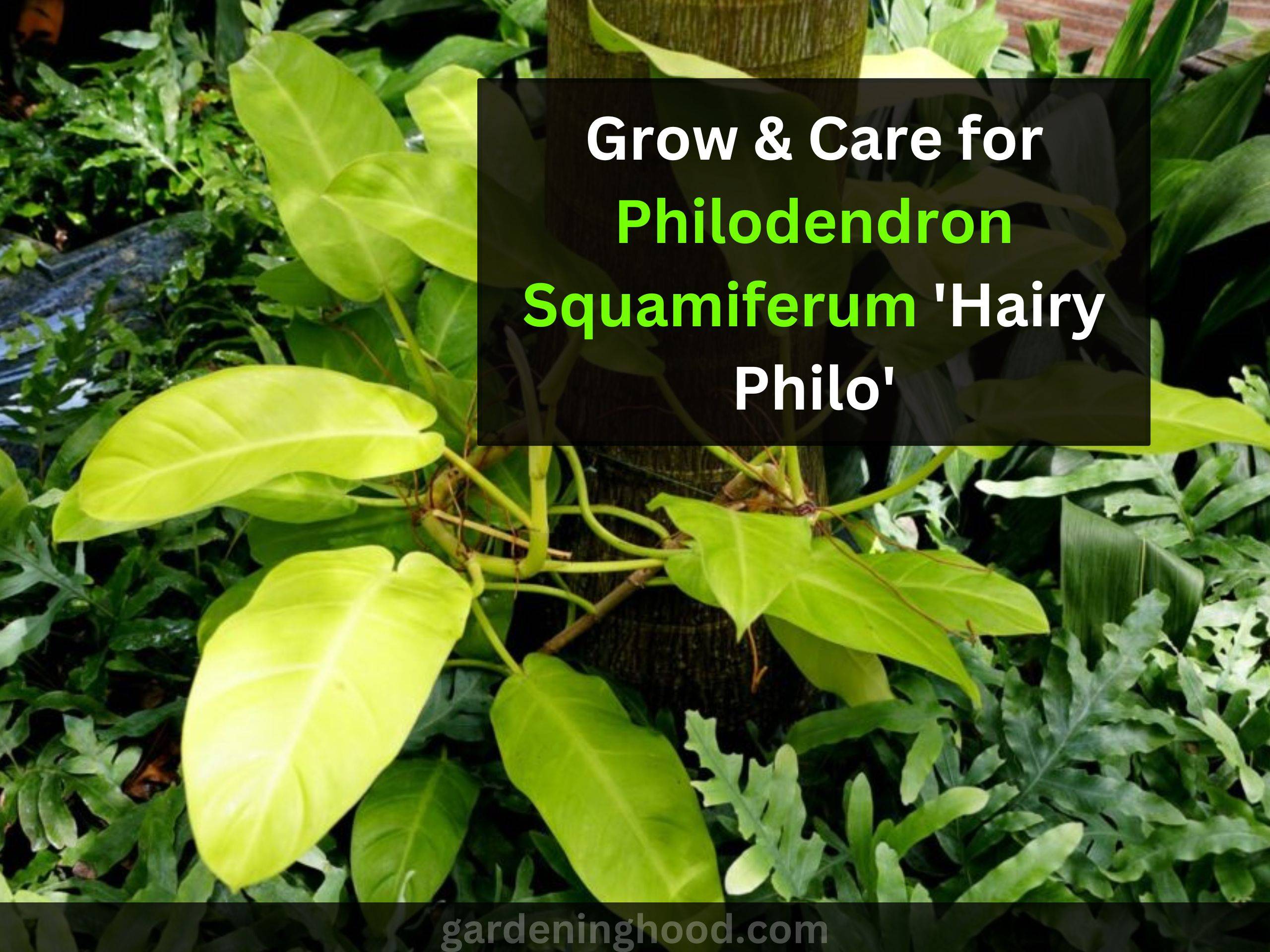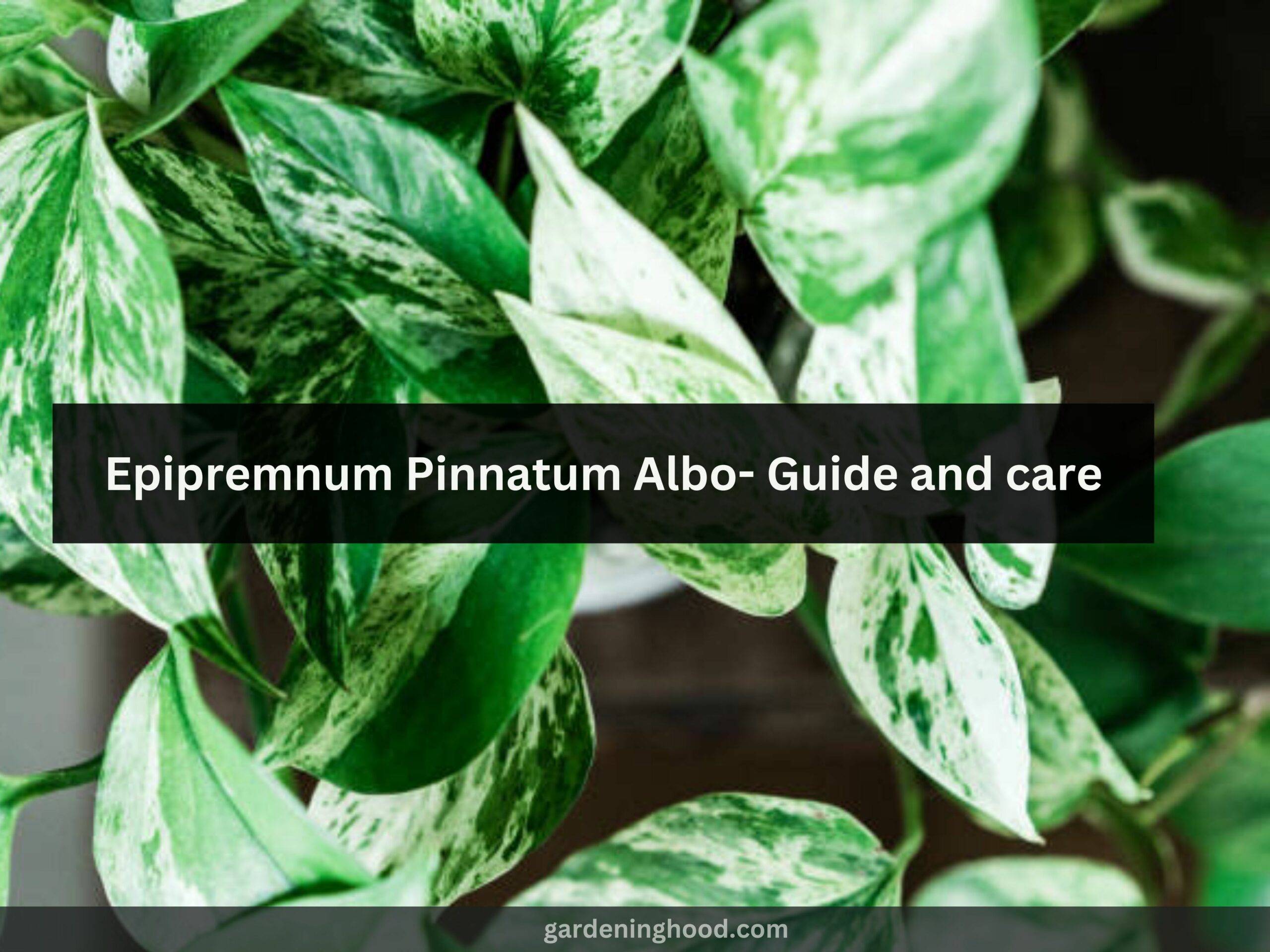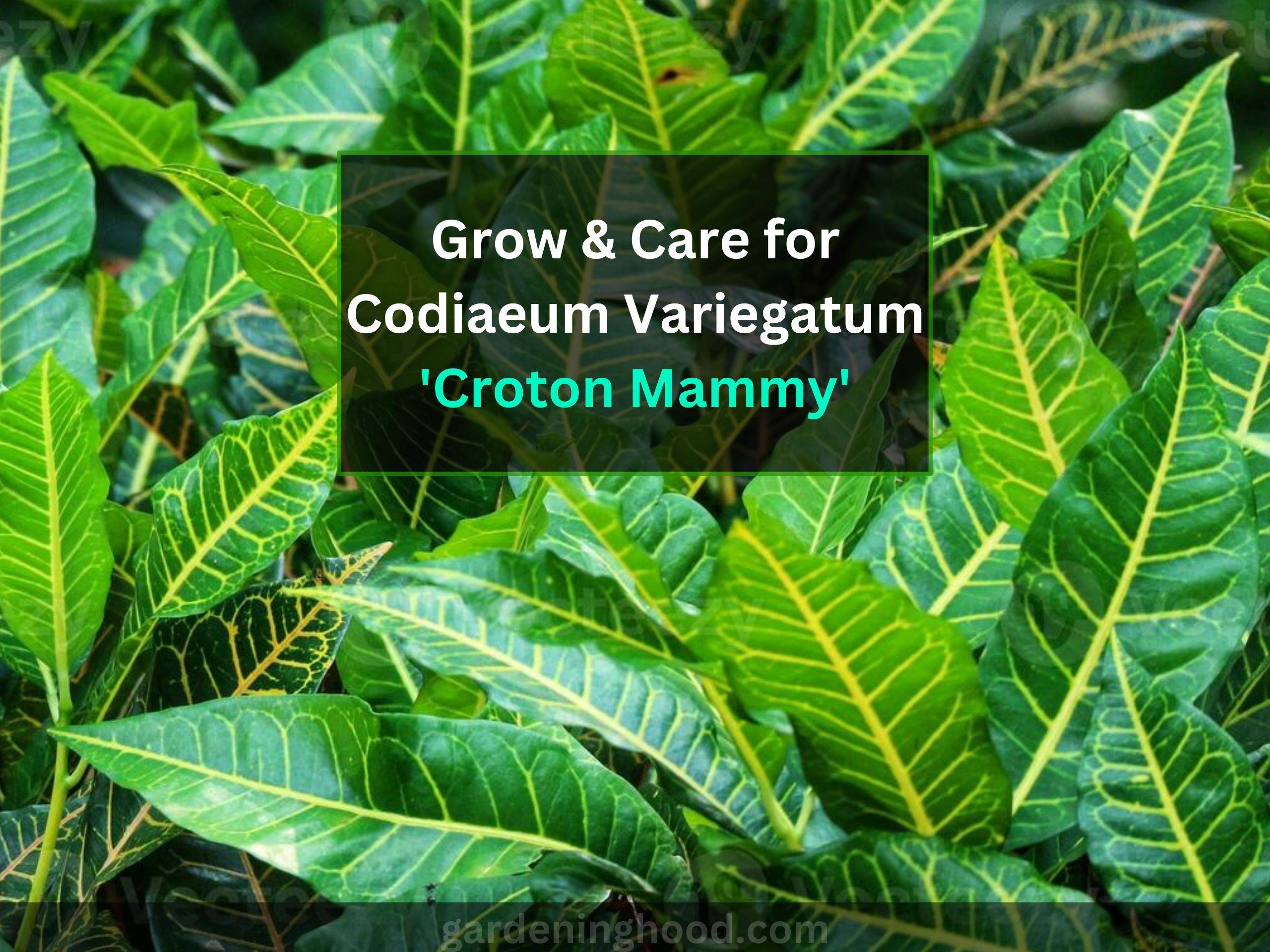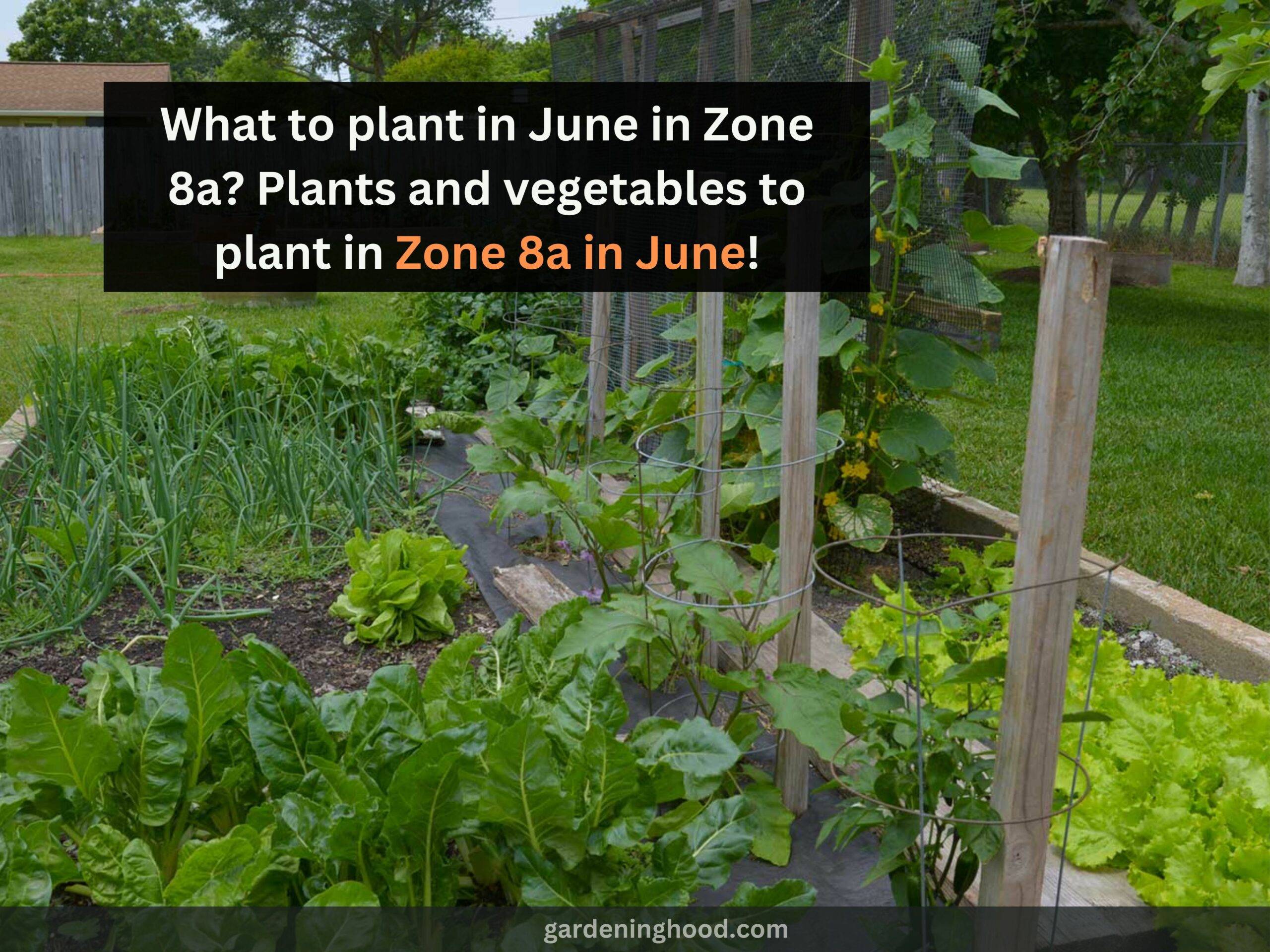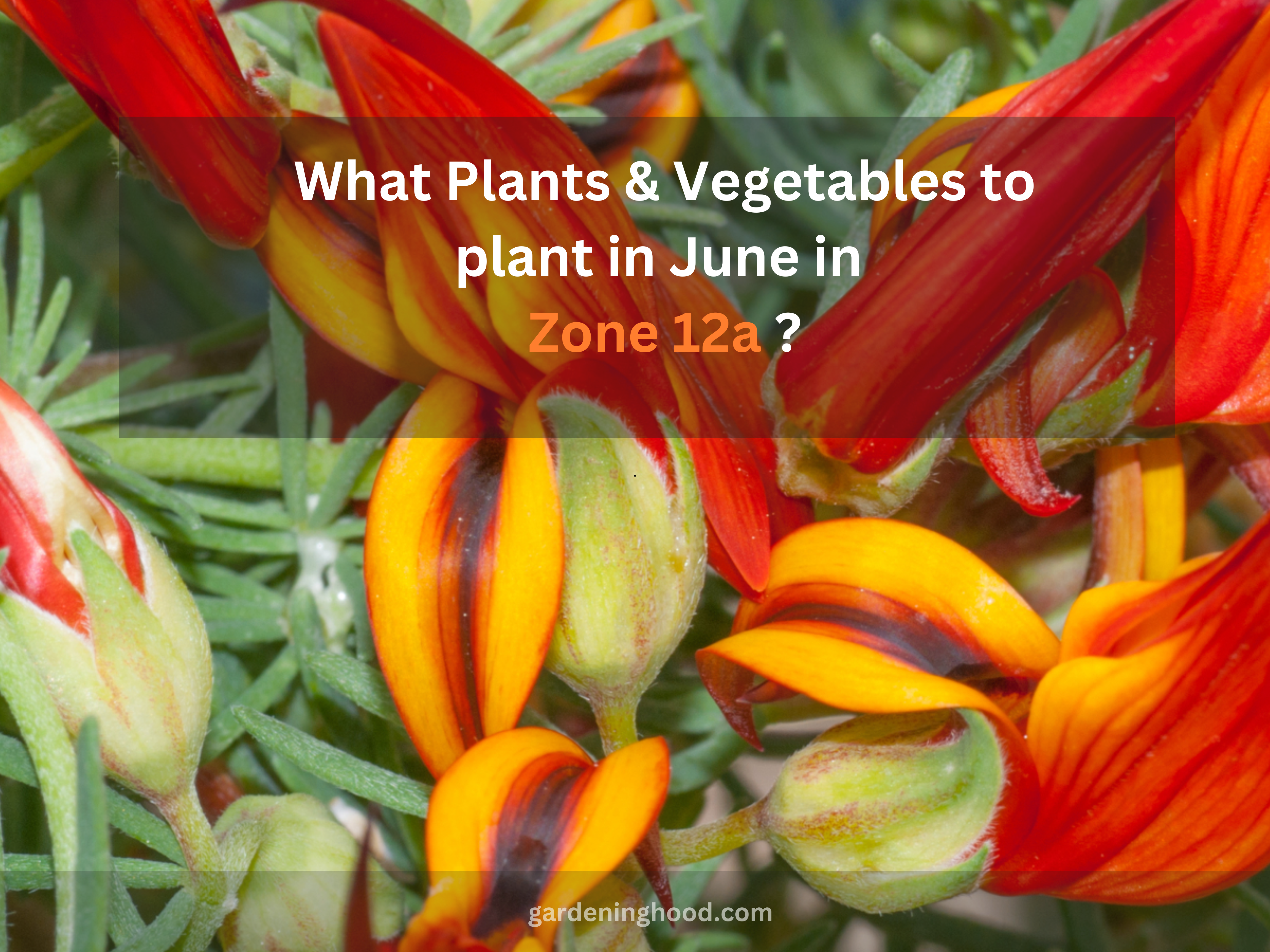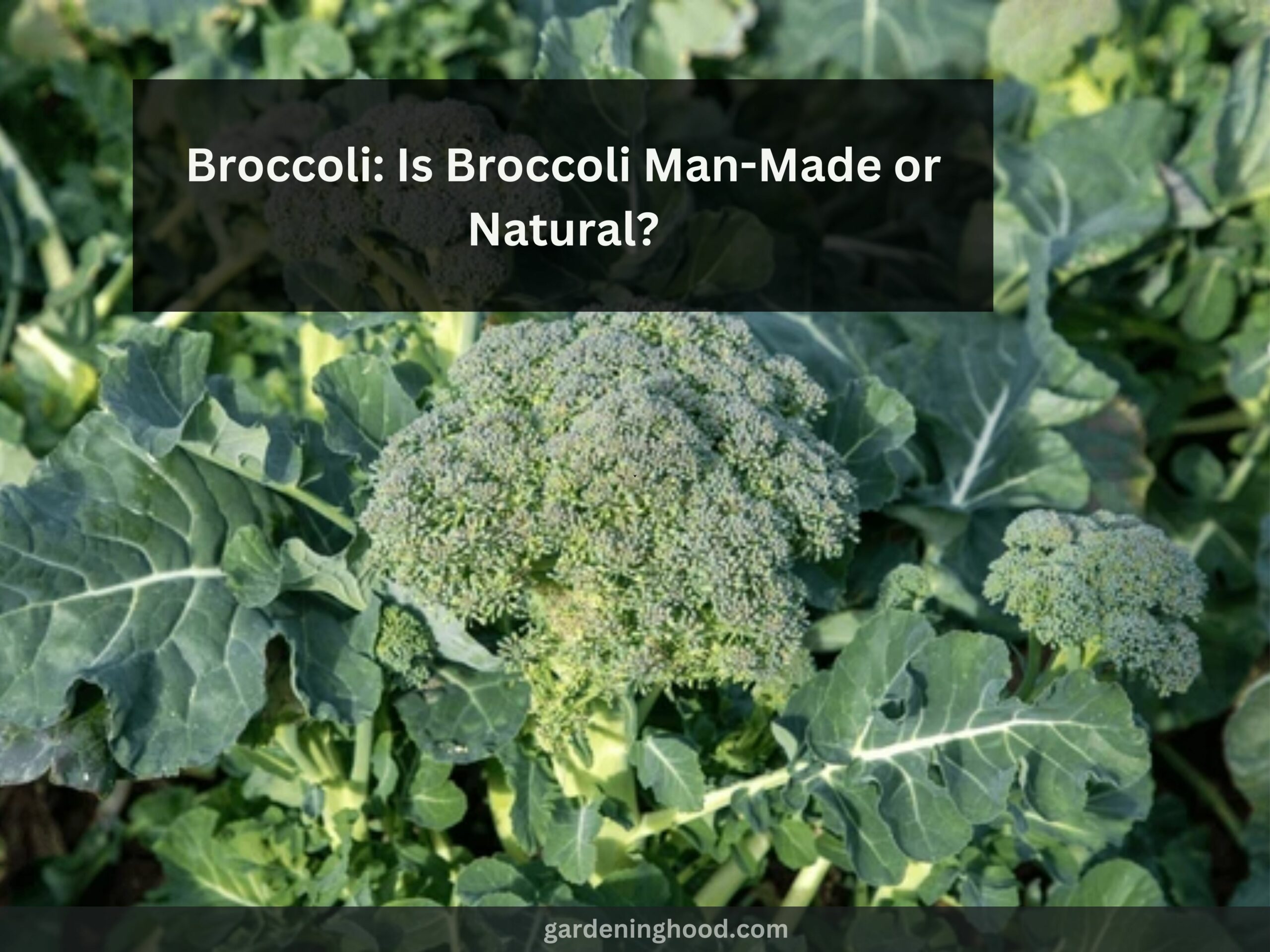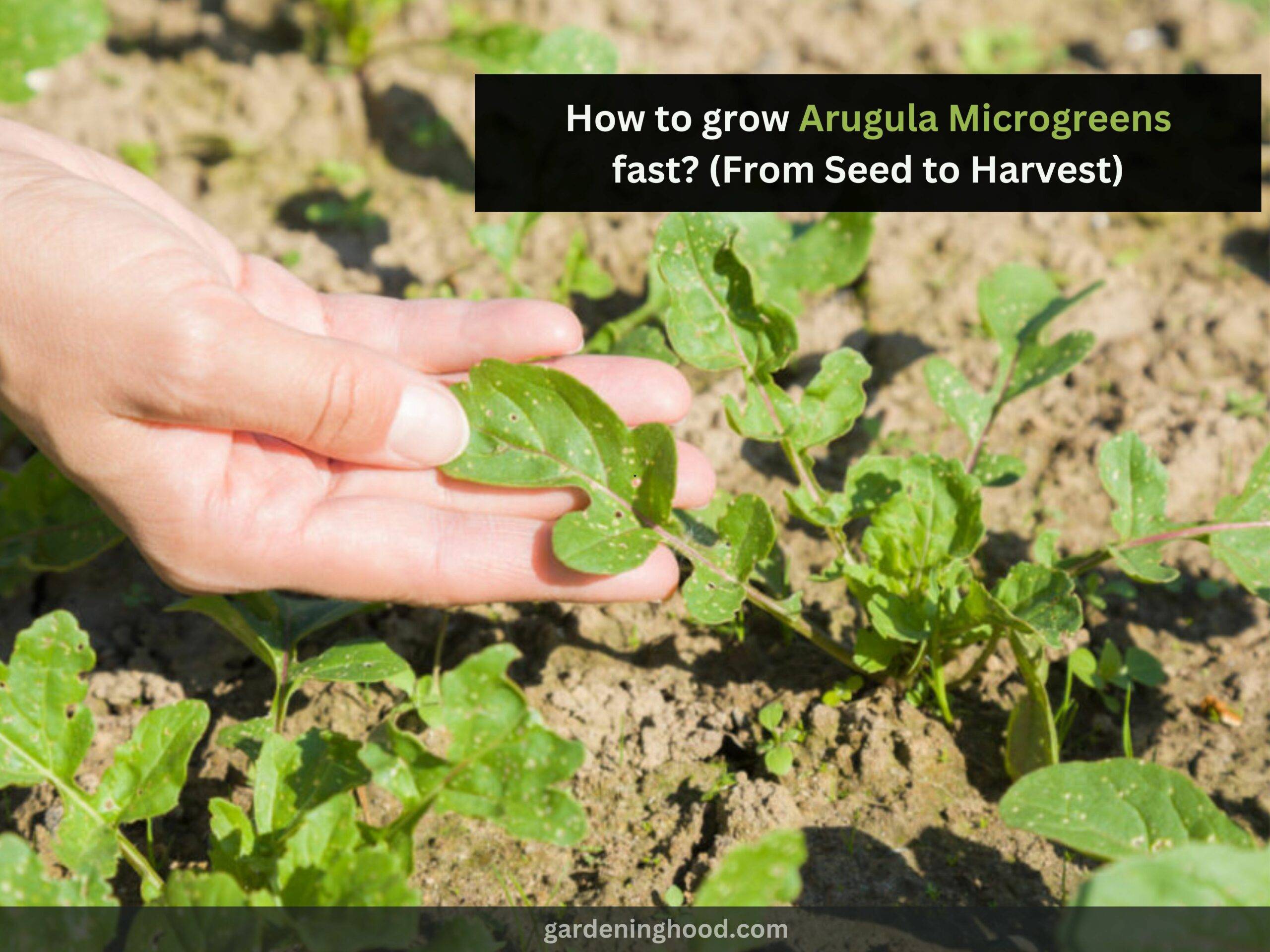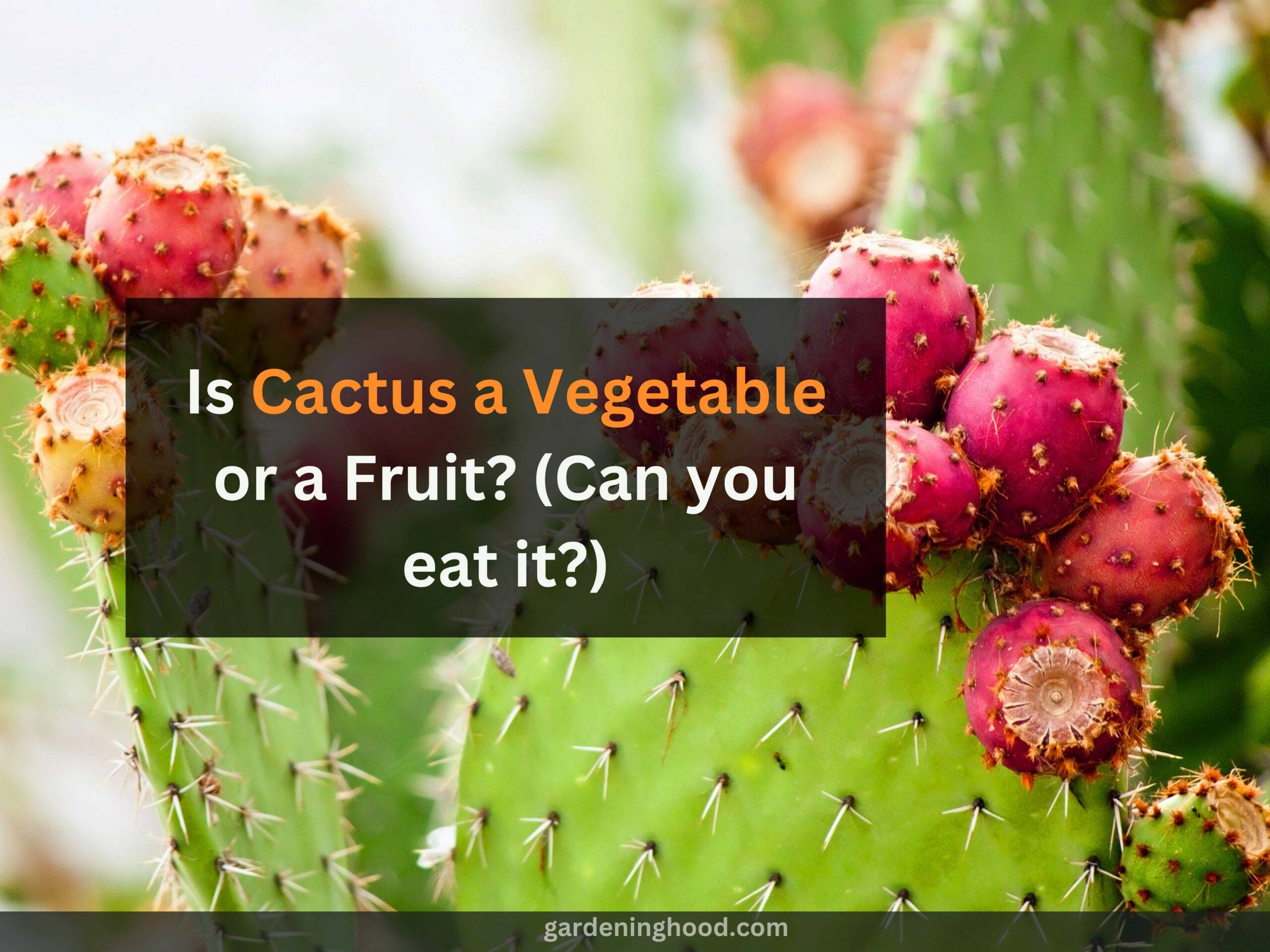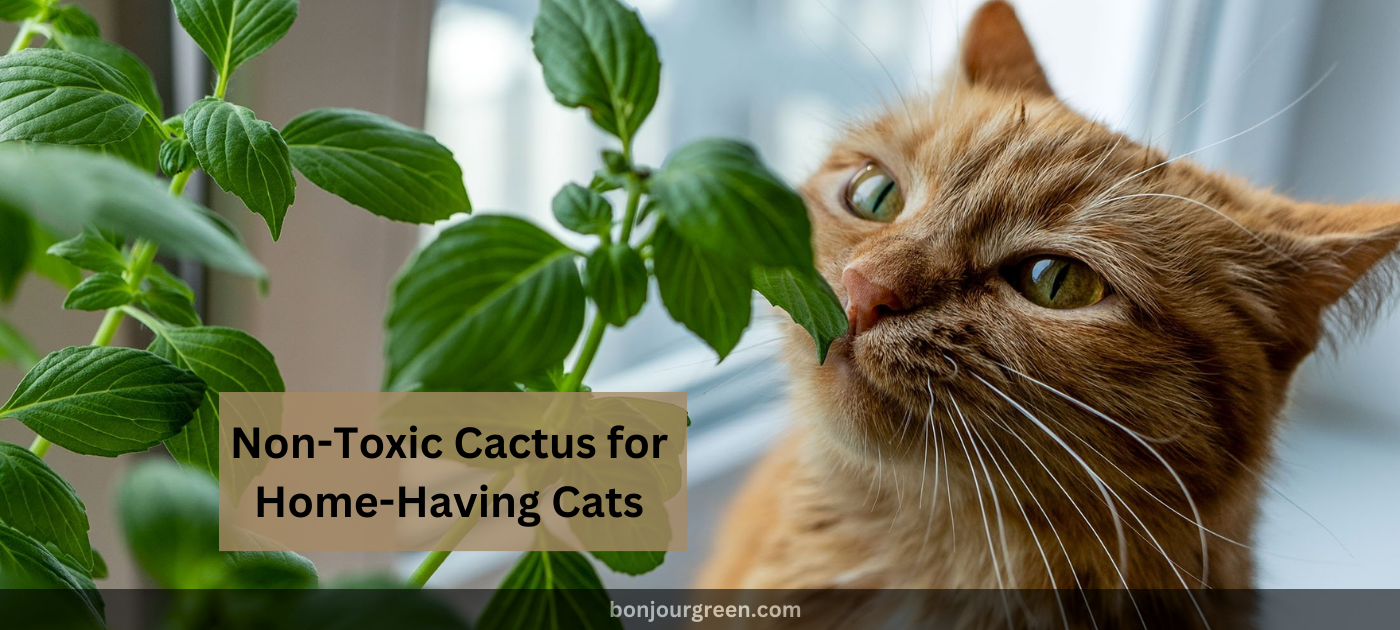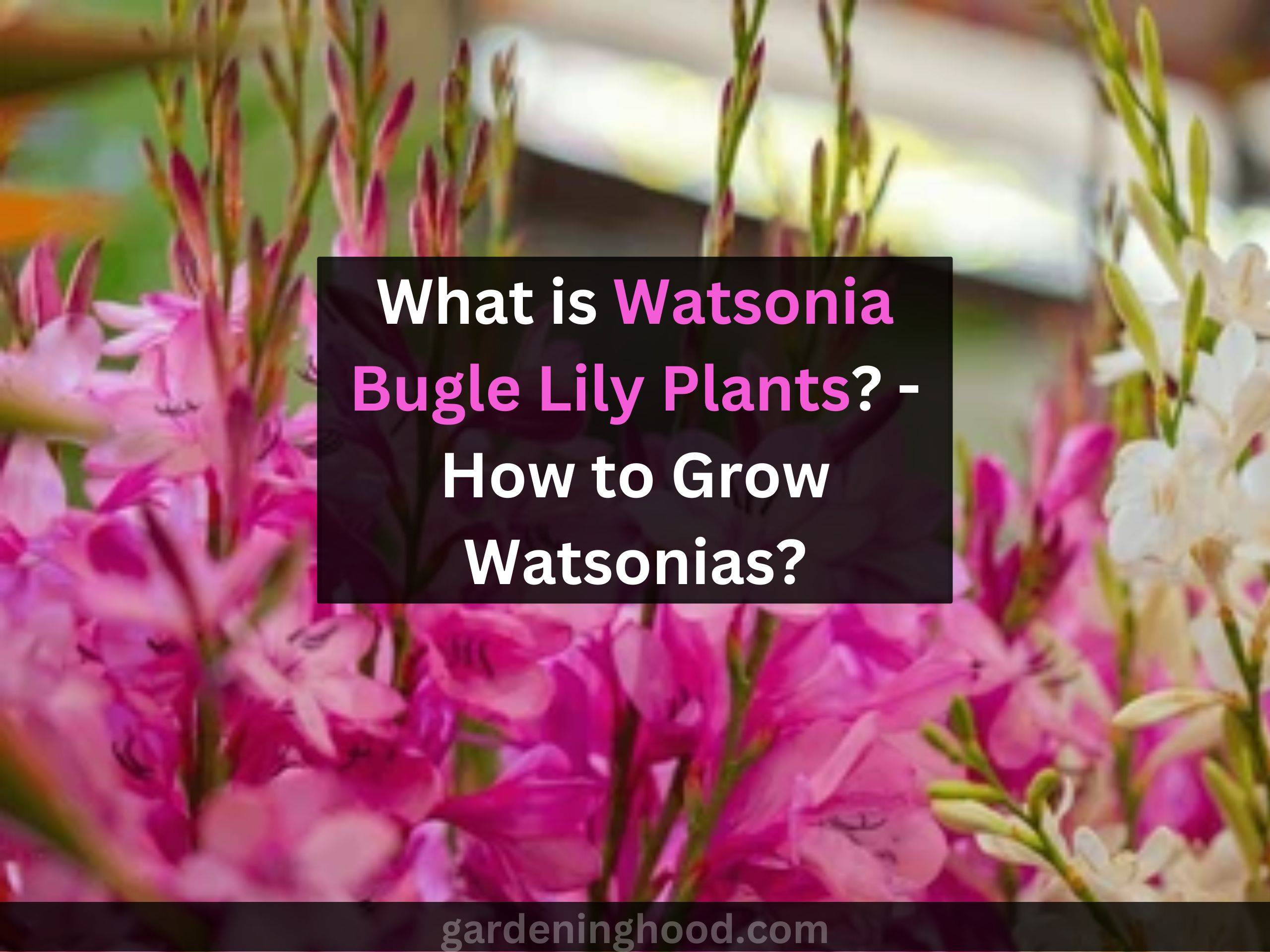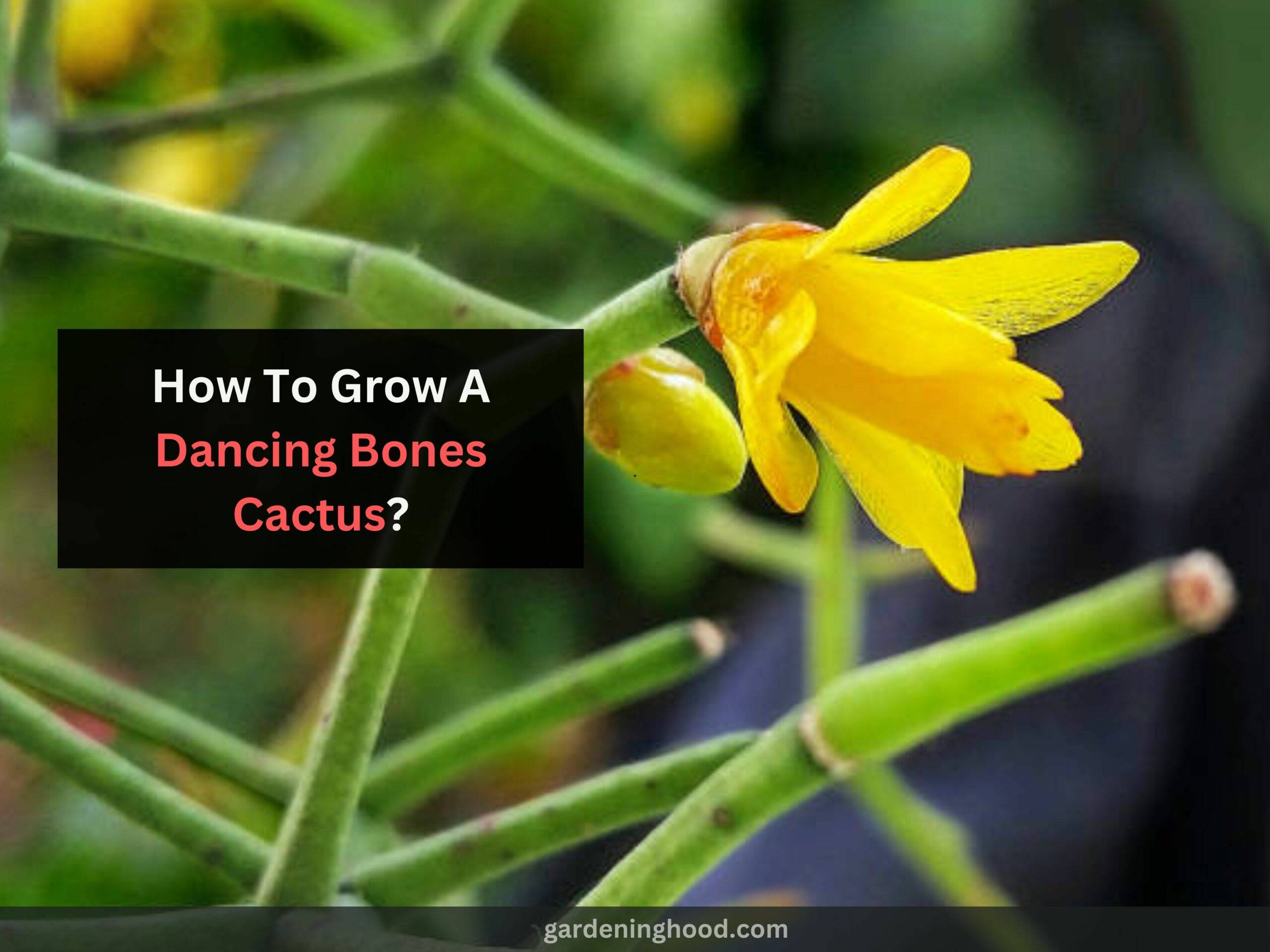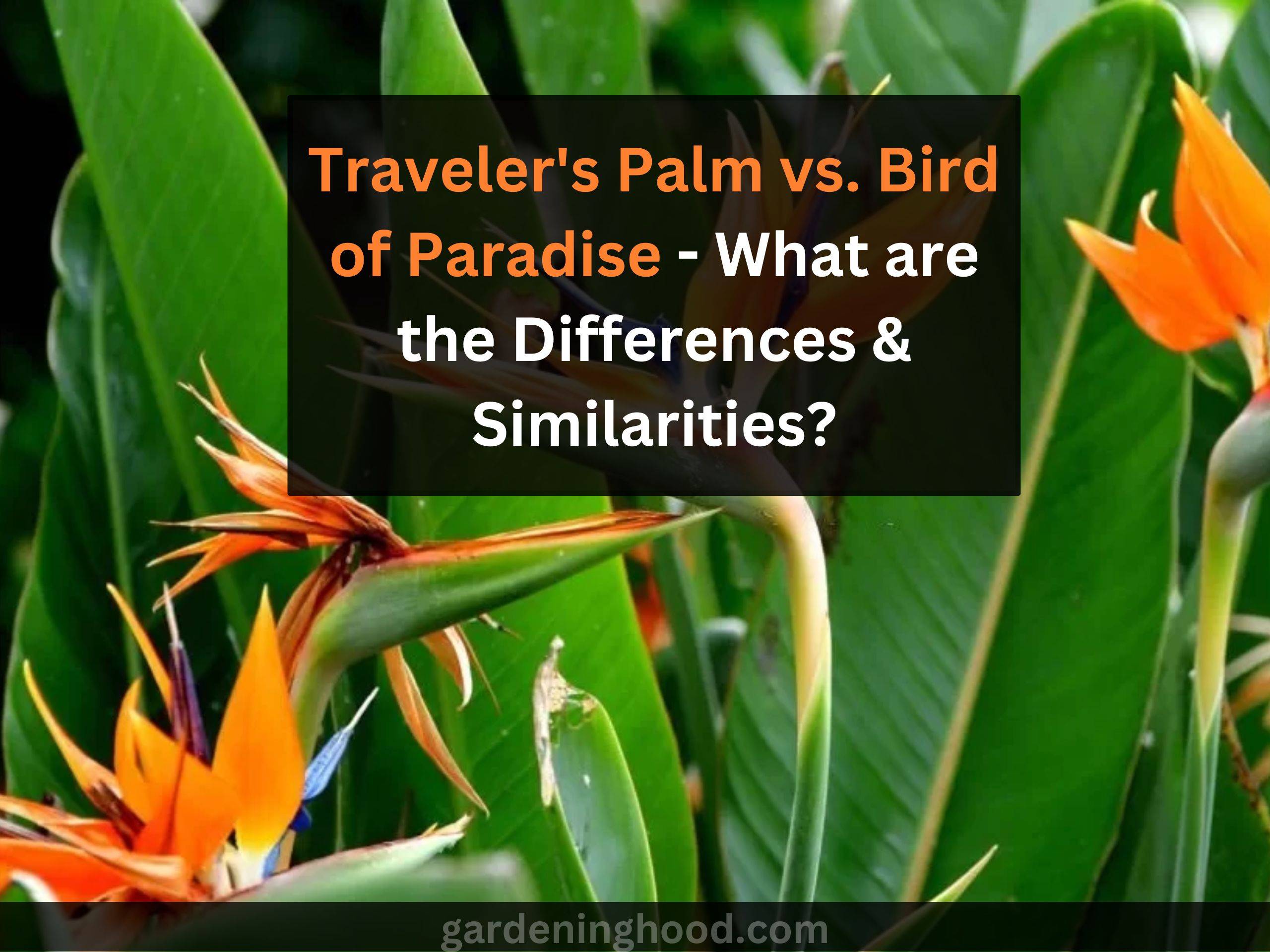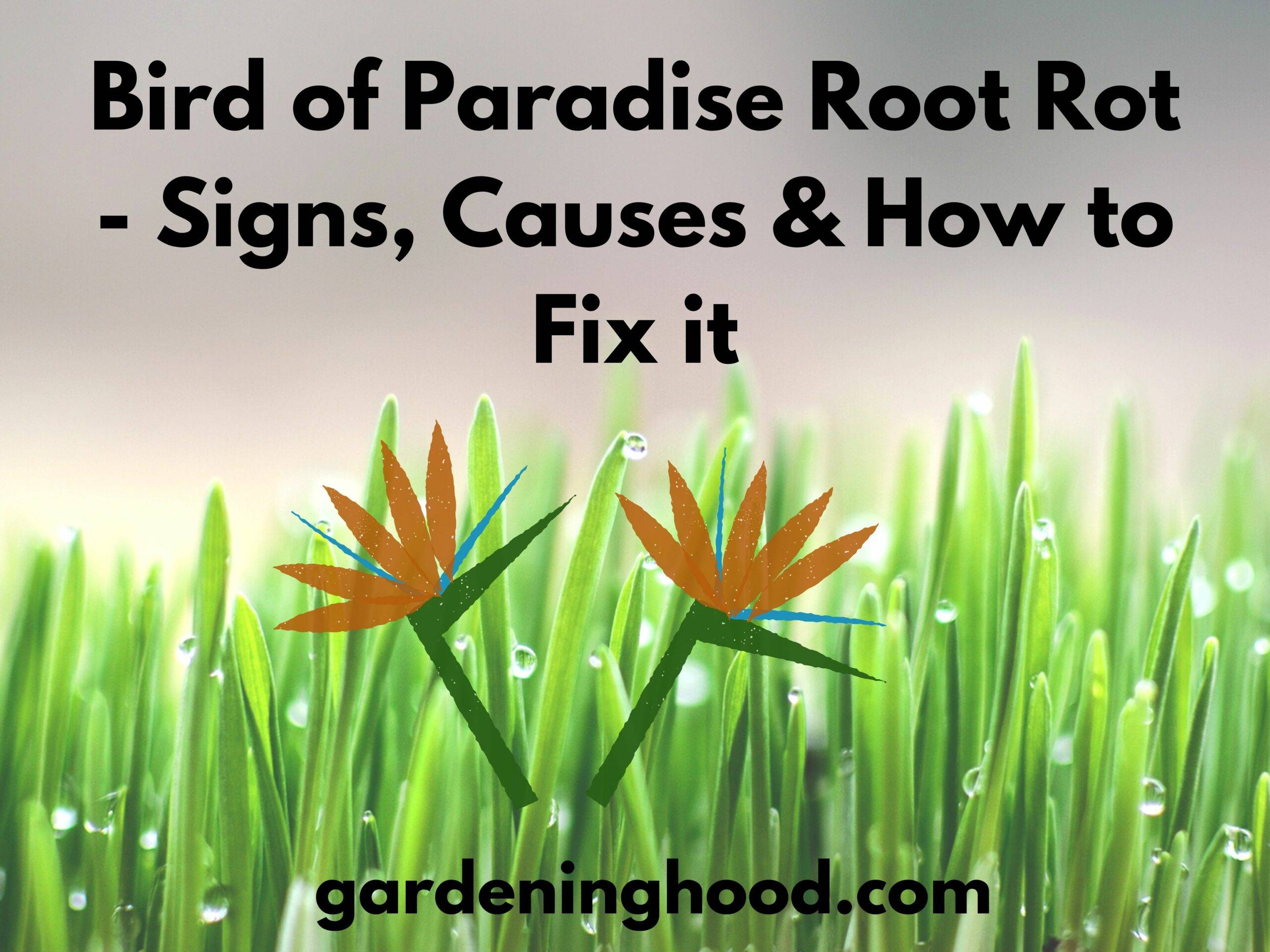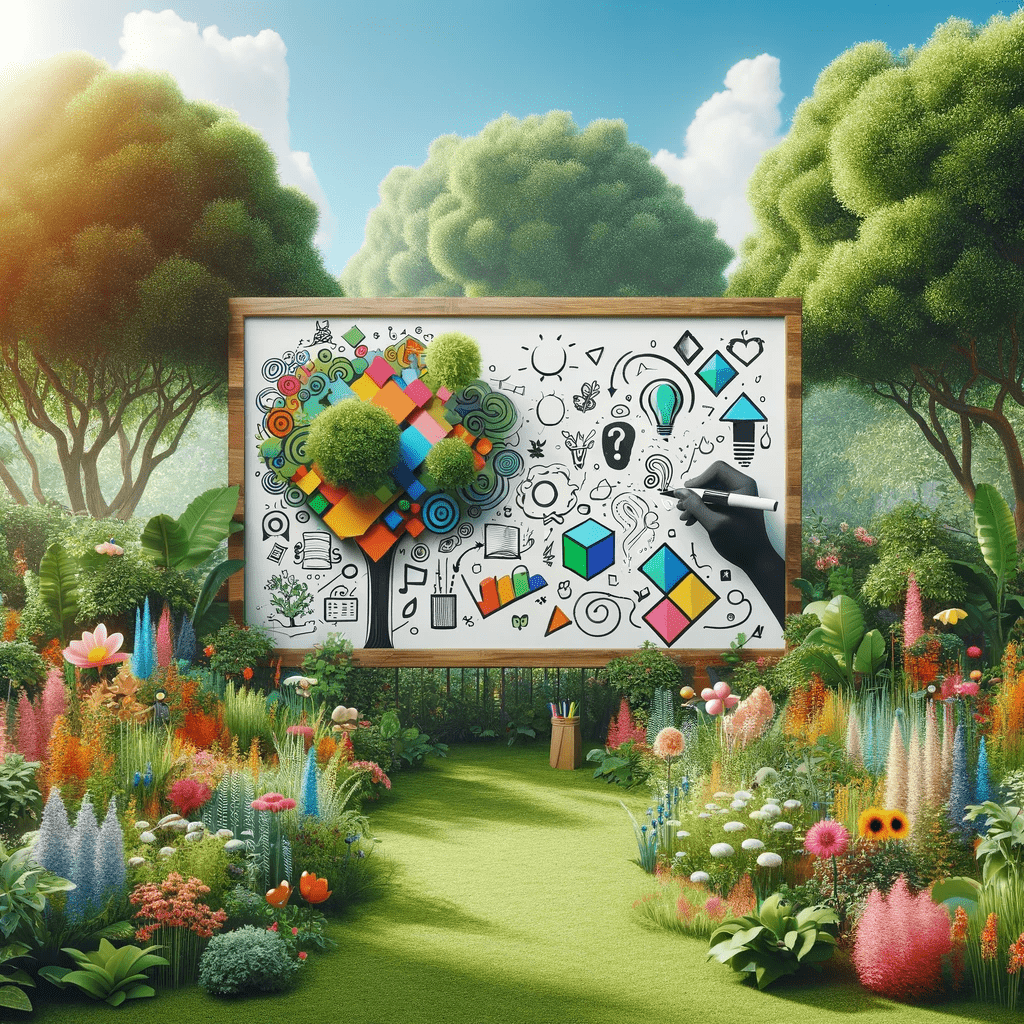How to Grow & Care for Kalanchoe Delagoensis ‘Mother of Millions’ (2024)
April 2, 2024
No Comments
Are you looking to grow fast-growing plants in your home garden? If yes, then why not try Kalanchoe Delagoensis? It is also known as Mother ...